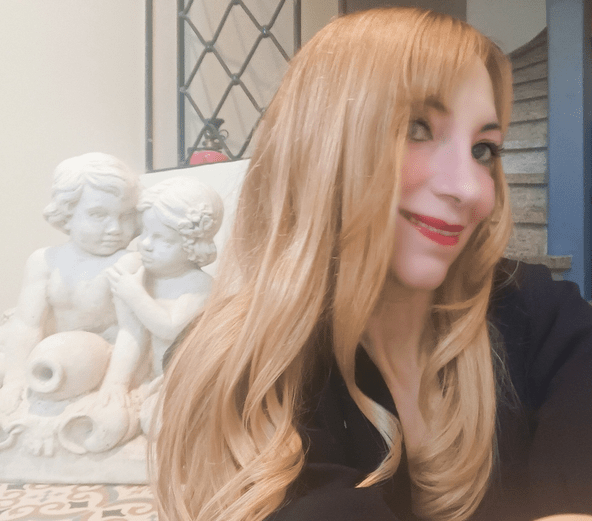
On l’entend partout : dès qu’une personne raconte un projet mené à bien, un changement de vie, un accomplissement, surgit cette sentence polie et un peu venimeuse : « C’est beau, mais tout le monde ne peut pas se le permettre ! » À force de l’entendre, on finirait presque par y croire ! Pourtant, cette phrase est souvent fausse, et surtout, elle nous empêche de voir ce que nos vies révèlent vraiment : des choix, pas des impossibilités. Comment y voir plus clair ? En lisant derrière les mots et en comprenant bien qu’il est plus facile de se donner des excuses que des objectifs bien concrets !
Je vais être directe : en dehors des situations où la maladie, la précarité ou un effondrement mental empêchent réellement d’agir, la plupart des “je ne peux pas” sont en réalité des “je ne veux pas assez”, “je ne veux pas payer le prix”, ou “je ne suis pas prêt à renoncer à telle chose”. Ce n’est pas un jugement. C’est un constat. Et tant qu’on se cache la vérité, on ne peut pas avancer. C’est la base de toute thérapie.
Psychologiquement, dire « je ne peux pas » est très confortable. Cela supprime la responsabilité personnelle et fabrique l’illusion d’une contrainte extérieure absolue : le travail, les enfants, le budget, la fatigue, la région, le métier. Une manière élégante de dire “la vie décide pour moi”. En réalité, c’est souvent un mécanisme d’évitement. On préfère croire à une impossibilité plutôt que d’avouer que certaines choses ne sont tout simplement pas nos priorités.
Prenons des exemples simples. Beaucoup de personnes affirment ne pas pouvoir acheter une maison, changer de vie ou partir plusieurs mois, tout en dépensant sans sourciller en vêtements, en restaurants, en manucures ou en voyages express. Non, ce n’est pas un manque de moyens : c’est un système de choix où la gratification immédiate passe avant la construction sur le long terme. Renoncer à un plaisir fait peur. Renoncer à un plaisir peut faire mal à l’ego. Économiser demande de la discipline. Et se priver temporairement n’a rien de séduisant. Alors on dit « je ne peux pas ». C’est plus doux que “je n’ai pas envie de faire les efforts que ça implique”.
Et puis, il y a la peur du changement, ce moteur invisible qui dicte plus de vies qu’on ne l’admet. Changer de région, changer de métier, réduire son confort, accepter l’inconnu : tout cela active nos alarmes internes. L’être humain préfère rester dans une situation qui ne lui convient pas tout à fait, plutôt que de s’aventurer vers une situation qui pourrait être meilleure mais qui le déstabilise. Alors, encore une fois, “je ne peux pas” sert de bouclier. On masque la peur derrière un argument financier ou logistique. Ça passe mieux. Sans compter le : « Si j’étais toi je ne le tenterais pas… Tu risques de perdre ta stabilité »…
Mais le plus intéressant, c’est la comparaison. Quand quelqu’un ose, fait, transforme, il devient un miroir gênant. Il reflète nos renoncements, nos immobilismes, nos rêves laissés de côté. Alors, pour atténuer ce petit pincement intérieur, on lance : « Vous avez de la chance ». Comme si la chance tombait du ciel, comme si certains recevaient un cadeau que d’autres n’auraient pas mérité. C’est une façon très élégante de dire : “Je n’ai pas fait ces choix-là, et ça me dérange un peu que tu les assumes.”
Prenons un exemple concret. Un couple, convaincu qu’il ne construirait jamais rien dans la ville où il vivait, a décidé un jour de prendre son libre arbitre au sérieux. Ils ont quitté la ville, changé de travail, et acheté une maison à rénover pour moins de 50 000 euros à la campagne. Sept années entières de travaux, de sacrifices, d’économie, de compromis, de soirées à poncer plutôt qu’à sortir, de vacances sacrifiées, d’anxiétés sur l’avancement. Sept ans à investir dans un projet plutôt que dans le quotidien. Quand la maison a été terminée, ils l’ont revendue. Avec cette plus-value, ils ont acheté plus grand, dans une région plus belle. Et autour d’eux, les réactions n’ont pas tardé : « Vous avez de la chance ! » Non. Ce n’est pas de la chance. C’est du choix. Du renoncement. De la discipline. De la volonté. De la persévérance. Ce que l’on nomme “chance” chez les autres est souvent la somme invisible de décisions courageuses.
On entend aussi cette phrase dans le domaine de la maternité, et elle en dit long sur nos mécanismes internes. Une femme raconte qu’elle allaite depuis un an, qu’elle a réorganisé son budget, son rythme et ses priorités pour que cela fonctionne. En face, une coiffeuse lui répond : « C’est super… mais moi, avec mon métier, je ne peux pas me le permettre. » Ce « je ne peux pas » n’est pas vrai. Pas dans le sens littéral. Allaiter un an en travaillant est difficile, contraignant, fatigant, parfois épuisant, mais c’est faisable lorsqu’on décide d’ajuster son mode de vie : dépenser moins, réduire le superflu, ralentir temporairement, réaménager son emploi du temps ou s’organiser autrement. Ce n’est pas l’impossibilité qui bloque, c’est le prix à payer. Et ce que cette phrase signifie réellement est plus inconfortable : « Ce n’est pas ma priorité. Je choisis de conserver mon niveau de dépenses, mon rythme, mon confort, mes habitudes. M’investir dans l’allaitement long n’est pas mon choix numéro un. » Ce n’est ni une faute, ni une preuve de mauvaise volonté : c’est un choix, simplement un choix. Mais dans un univers saturé d’injonctions maternelles, dire la vérité demande un courage énorme. Alors on préfère l’illusion de l’impossibilité : c’est le métier, c’est la vie, c’est “comme ça”…
En réalité, ce n’est pas le métier qui empêche. Ce sont les priorités qu’on ne veut pas nommer. Et tant qu’on continue à se cacher derrière un « je ne peux pas », on se prive de la seule chose qui libère vraiment : reconnaître que l’on choisit. Que l’on choisit toujours, même quand on prétend que non.
Dans une société où tout doit être confortable, où l’on voudrait la réussite sans la frustration, et les changements sans efforts, le libre arbitre est presque devenu tabou. Pourtant, il est central. Le libre arbitre, ce n’est pas la capacité à faire exactement ce qu’on veut. C’est la capacité de choisir ce qu’on fait avec ce qu’on a. Et surtout d’assumer ces choix. Il n’est pas nécessaire de tout vouloir. Pas tout le monde veut allaiter un an, acheter une maison, voyager seule, déménager ou changer de métier. Et c’est très bien ainsi. Ce qui fait souffrir, ce n’est pas le choix que l’on fait. C’est de croire qu’on n’a pas choisi.
On se prive d’un immense pouvoir en refusant simplement de reconnaître que notre vie est construite par nos décisions — les petites, les grandes, les conscientes, les automatiques.
Dire « je choisis autrement », c’est affranchissant. C’est adulte. C’est aligné.
Dire « je ne peux pas », quand ce n’est pas vrai, c’est s’enfermer dans une cage dont la clé est dans notre poche.
La liberté commence souvent là : dans la lucidité un peu brutale, mais profondément libératrice, de dire
« Ce n’est pas que je ne peux pas. C’est que je choisis autre chose. »
Et c’est peut-être la seule phrase qui permet vraiment d’avancer.

